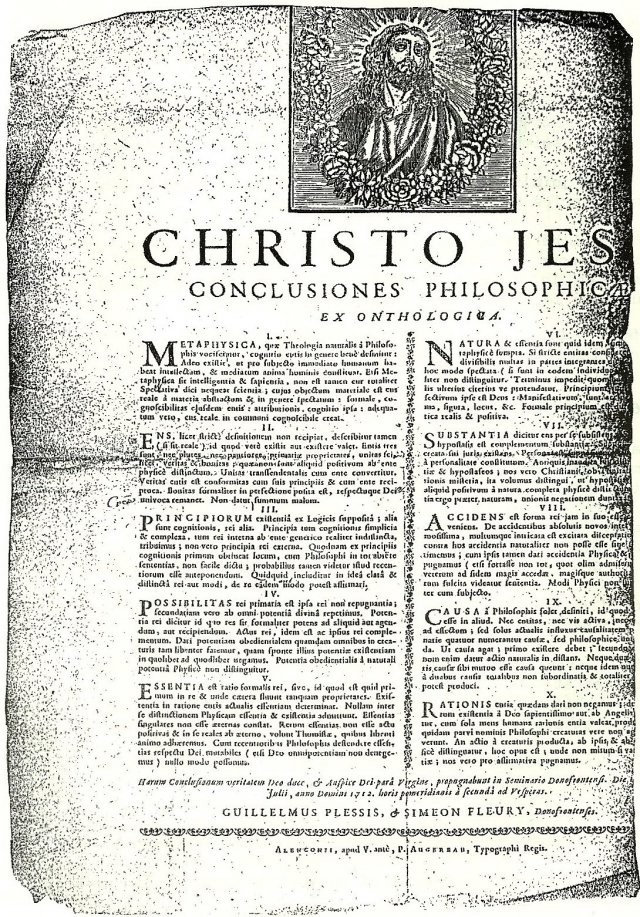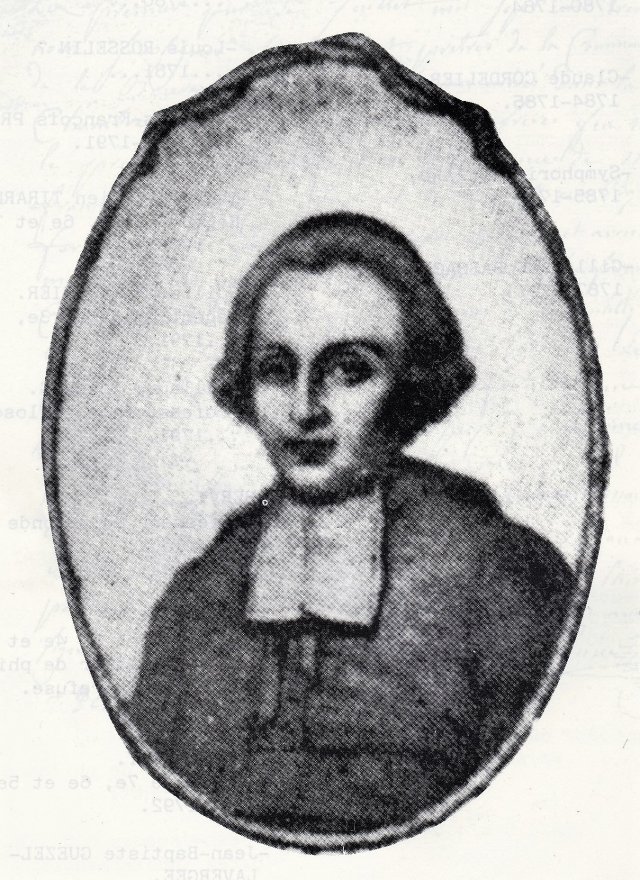Quelle est l’essence du temps ? Qu’est-ce qui le constitue au plus intime exactement ? Est-ce la destruction ? Il est vrai que rien ne résiste au temps, que tout cède devant lui. Mais centrer la définition du temps sur la destruction, c’est oublier que le temps c’est aussi la vie et que rien ne se fait sans lui. Le temps présente en effet des facettes positives et ne voir en lui qu’une puissance destructrice serait l’aborder de manière réductrice. Comment alors définir la nature propre du temps si, tel un Janus, il présente deux visages diamétralement opposés ? Ne doit-on pas renoncer à concevoir son unité et la penser comme pleinement double ?
 Le temps est-il essentiellement destructeur ?
Le temps est-il essentiellement destructeur ?