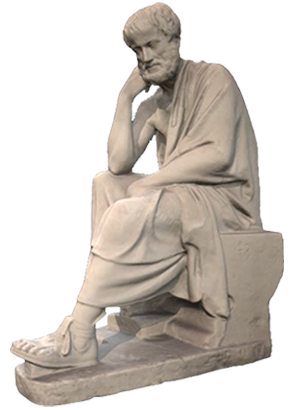Un double processus
Le caractère destructeur du temps
Héraclite et le mobilisme universel

Abraham Janssens van Nuyssen, Héraclite, v. 1609,
huile sur toile, 64,1 x 50,8 cm, collection privée. |
Dans un autre fragment, Héraclite compare le temps à un enfant joueur : « Le temps est un enfant qui joue en déplaçant les pions : la royauté d’un enfant » [8]. Comment comprendre cette mystérieuse déclaration ?
Les Grecs du VIe siècle avant notre ère avaient pour habitude de jouer à un jeu, celui de la petteia (πεττεία, en grec ancien) ou jeu des « jetons » (pessoi/πεσσoί) [9], un jeu de stratégie s’apparentant au jeu de dames. Les pions se déplaçaient sur cinq lignes horizontales et cinq lignes verticales, soit vingt-cinq points d’intersection. Chaque joueur avait cinq pions d’une couleur différente, généralement noire et blanche, et l’objectif était de bloquer le pion de l’adversaire entre deux pions à soi. Héraclite avait-il à l’esprit ce jeu lorsqu’il présente le temps comme un joueur ? C’est l’hypothèse qu’avancent d’éminents commentateurs d’Héraclite [10]. Dans la petteia, les pions forment en effet un étau qui se resserre. Or, c’est justement l’effet du temps sur l’être humain : l’espace de liberté de l’homme qui va vers la mort se resserre comme celui du joueur qui pressent l’échec. Progressivement, la vieillesse, la maladie et tous les effets négatifs du temps immobilisent l’homme, immobilité qui signifie pour lui la mort. Car le jeu des jetons est une sorte de jeu de guerre qui se termine par la défaite de l’adversaire. Peu à peu, le joueur perd ses pions et un renversement de situation s’opère qui s’avère fatal.

Exékias, Achille et Ajax jouant, 540-530 av. J.-C,
amphore attique à figures noires, provenance Vulci, hauteur 61 cm, Musée grégorien étrusque, Vatican. |
L’entropie et la dimension tragique du temps
La puissance du temps est donc tragique non seulement parce qu’elle rejette tout ce qui est dans le néant, mais également parce que les êtres humains doivent lui être soumis comme des éléments parmi d’autres de la nature. D’où la comparaison que fait le poète et philosophe allemand Friedrich Hölderlin entre les hommes qui meurent et l’eau qui tombe, projetée de rocher en rocher :
« Mais à nous il échoit
De ne pouvoir reposer nulle part.
Les hommes de douleur
Chancellent, tombent
Aveuglément d’une heure
À une autre heure,
Comme l’eau de rocher
En rocher rejetée
Par les années dans le gouffre incertain ». [14]
Cherchant en vain à retenir le temps – et à se retenir – mais subissant sans jamais pouvoir l’arrêter son écoulement, les hommes sont jetés en avant d’eux-mêmes, forcés à aller d’un pas obligatoire vers un avenir inconnu, vers l’« incertain », pour finir par tomber, sans jamais pouvoir l’éviter, dans le « gouffre » de la mort. Sombre métaphore qui donne à penser dans un langage poétique ce qu’a de dramatique la vie des êtres humains, le cours du temps les entraînant inexorablement vers leur destin.

Alberto Giacometti, L’homme qui marche I, 1960,
sculpture en bronze, 183 x 25,5 x 95 cm, Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence. |
Le temps comme source d’altération et de corruption
La force créatrice du temps
Vers une réhabilitation philosophique du temps
Hegel et le progrès historique

Mnémosyne, v. -25 av. J.-C - 100 ap. J.-C.,
château de Compiègne (photo Michel Chretinat, 2010). |
Le temps comme puissance de création continue
Temps et destin
La mort, une objection au sens de la vie...

Francisco de Goya, Saturne dévorant un de ses fils, 1819-1823,
huile sur toile, 146 x 83 cm, Musée du Prado, Madrid (détail). |
... ou une invitation à l’action ?

Albrecht Dürer, Le Chevalier, la Mort et le Diable, 1513,
gravure sur cuivre, 24,6 x 18,8 cm, Musée des Offices, Florence. |
La sagesse tragique
Résister au temps, voilà donc ce à quoi l’homme s’est toujours efforcé pour ne pas sombrer dans un pessimisme radical. Cette lutte a engendré en lui un ressentiment contre le temps qui a conduit les grands systèmes de pensée religieux et métaphysiques à déprécier tout ce qui est éphémère et à n’accorder de valeur qu’à ce qui demeure. Or cette attitude vis-à-vis du temps est équivoque car, si elle exprime le refus de se résigner, elle apparaît également comme une attitude de fuite et d’irresponsabilité puisqu’en cherchant à esquiver, à amortir ou à abolir la puissance du temps, on oublie sa condition d’être mortel et on refoule la crainte de la mort au lieu de l’assumer dans le courage. Ne doit-on pas alors vivre notre rapport au temps autrement ? Accepter notre condition et en dérouler la logique jusqu’au fond, en admettant que, face au temps, on est sans possibilité de soustraction ou d’exception ? En ne se masquant pas ce qu’il y a d’effrayant et de dérisoire dans la condition humaine mais en assumant notre destin et en regardant les choses sans illusion ? On peut en effet considérer comme illusoires toutes les suppositions prétendant évacuer la négativité du temps, non parce qu’elles seraient fausses (on ne peut pas démontrer que Dieu n’existe pas ou que l’âme ne survive pas indéfiniment), mais parce qu’en dissimulant le néant auquel tout est voué et l’impuissance fondamentale de l’être humain face au passage du temps, à l’oubli et à la mort, elles escamotent la réalité et font ainsi fonction d’illusion. Mais quel avantage trouvera-t-on à vivre sans œillères ? À vivre en mortel ?
Vivre en admettant que nous ne disposons que d’une part de temps limitée et que l’anéantissement est notre destin comme celui de tout ce qui est, c’est vivre en vérité et dans la responsabilité, sinon on vit dans la fausseté et l’irresponsabilité en se masquant ce qui nous attend et en refusant d’assumer la brièveté de la vie. Vivre de cette manière permet également de vivre sereinement et aussi joyeusement que possible car à se faire l’ennemi du temps, on se condamne à le subir comme une puissance adverse, ce qui peut susciter des sentiments négatifs comme la haine envers lui ou la tristesse d’avoir à vivre en lui, alors que consentir au temps permet de moins en pâtir puisqu’en se laissant aller avec lui d’un même pas, on peut en faire un complice et en éprouver la puissance créatrice.
Si donc l’on se place dans l’hypothèse que rien ne peut nous sauver du temps qui passe, il ne nous reste plus qu’à surmonter courageusement la crainte de la mort, sans chercher à la refouler et sans avoir besoin pour y faire face de déprécier la vie mais en accordant au contraire la plus haute valeur à ce qui périt. Sachant que le néant est notre étoffe même et que l’on vit pour rien, il nous faut vivre comme le héros qui, devant le défi de la mort, refuse – pour rien – de se laisser abattre. Si cette attitude est aussi une lutte, ce n’est pas pour s’arracher au temps. Son combat a un autre objet. Prenant le parti du temps, elle ne vise pas à l’affronter en face-à-face mais à l’organiser activement pour ne pas le subir passivement. À l’employer en lui donnant un sens par l’art, l’amour, la connaissance ou la moralité ; en le soumettant à une idée ou à un idéal comme celui de la beauté, de la liberté ou de la justice ; bref à vivre notre temps de vie non pas en le laissant passer ou en l’occupant à des activités futiles, comme jouer aux cartes ou fumer tranquillement, mais en l’employant aussi intensément que possible. Une telle attitude conduit à se tourner vers une autre sagesse que celle léguée par la religion et la métaphysique. Une sagesse tragique qui, loin de chercher un remède à l’angoisse, loin aussi de nourrir une hostilité à l’égard du devenir et de rabaisser tout ce qui est passager, porte au plus haut degré ce qui fait la valeur de la vie et invite à trouver la grande passion qui donne la force de vivre dans le temps et d’affronter un destin écrasant.

Marc Chagall, Le temps n’a point de rives, 1930-1939,
huile sur toile, 100 x 81,3 cm, collection Ida Chagall, Paris. |